Toujours plus de seniors dans les prisons romandes!

Les prisons n’ont pas été construites pour des personnes d’un certain âge, mais bien pour des détenus jeunes et vigoureux. Des cellules spartiates aux salles de musculation, de la promiscuité des douches aux couloirs bruyants, l’univers carcéral ne fait pas cas de la vieillesse. Normal, il y a une vingtaine d’années encore, les moins de 60 ans représentaient la quasi-totalité des détenus. Mais aujourd’hui la population carcérale vieillit. Et les projections sont devenues un casse-tête pour les politiques ou un sujet d’étude pour de nombreux scientifiques.

« De 1984 à 2013, le nombre de détenus de 60 ans et plus est passé de 58 à 176 », explique Nicolas Queloz, professeur de droit pénal et de criminologie à l’Université de Fribourg. « En 2050, il devrait être de 1900 soit une augmentation de plus de 1000 % ! C’est une réalité avec laquelle le milieu pénitentiaire devrait déjà être familiarisé. »
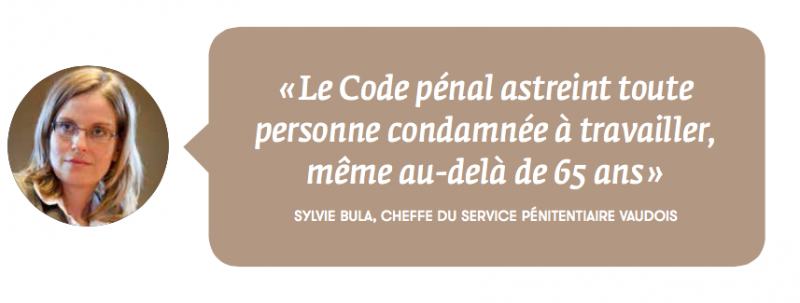
C’est le cas...
publicité
La suite est réservée à nos abonné·e·s
Découvrez nos offres d’abonnement
Déjà abonné·e ? Se connecter


